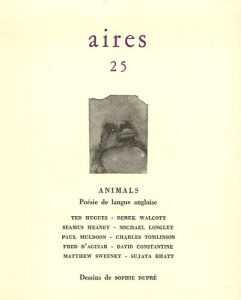
Une amie, qui ne connaît strictement rien aux revues quoiqu’elle lise beaucoup par ailleurs, me disait dernièrement : « Quand tu me parles de revues, j’ai l’impression de recevoir une carte postale d’un pays que je ne connais pas ». Compliment ou pas (voulait-elle dire par-là que ma conversation la dépaysait ?), toujours est-il que l’image m’a plu et je l’ai conservée dans un coin de ma tête. La voilà qui ressurgit aujourd’hui sous la forme de cette chronique. Ici, régulièrement, on voyagera dans et avec les revues d’hier et d’aujourd’hui. _Léo Byne.
*
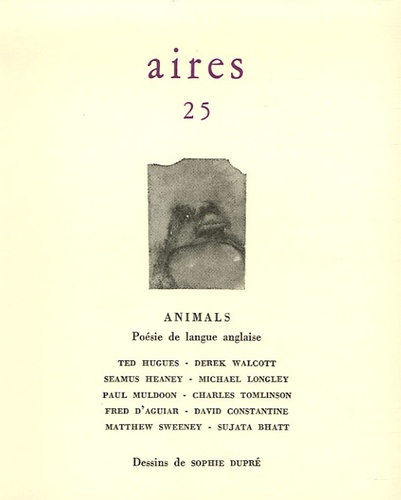
Voilà peu j’étais de passage à Lyon. Le jour où Sieur Montebourg faisait l’ascension du mont Beuvray entouré d’un aréopage de journalistes exaltés, je progressais quant à moi sur les pentes de la Croix-Rousse, agacé par un escadron de moucherons excités. C’était signe, cette agitation zézayante, d’un orage imminent. Et ça n’a pas manqué. Voilà qu’une sérieuse averse commençait à battre pavé. Un abri, vite ! Par chance, juste avant que le ciel ne me sauce complètement, j’avisais une librairie d’occasion fort joliment baptisée d’ailleurs « Le Livre en pente ». Pour un amateur de revues et pour échapper à la pluie, on ne saurait trouver mieux comme refuge. La mèche détrempée, me voilà donc fouinant dans les rayons à la recherche de quelque trouvaille. Bonne pioche : j’ai acheté un exemplaire défraichi de Aires*, une revue que je ne connaissais pas. Défunte en 1997 après vingt-cinq livraisons et douze ans d’existence, cette revue de poésie ancrée en pays de Loire aimait visiblement à franchir les frontières, si l’on en croit le rappel de ses sommaires : de langue allemande ou américains, arabes ou albanais, des Açores ou des Canaries, les poètes ici réunis venaient de tous les horizons. Le numéro que j’ai en main est précisément l’ultime, estampillé 25 et portant sur la poésie animalière anglo-saxone. Ted Hughes en vedette y signe un poème sur les grives. Ailleurs, sous d’autres plumes (celles de Derek Walcott, Seamus Heaney, Michael Longley, etc.), il sera successivement question de l’hautaine quoique sotte poule, du va-et-vient vrombissant de la mouche à miel, de la mythologique baleine, de l’insaisissable truite, de la sensualité iodée des huîtres s’offrant à des palais gourmets et avertis, et puis aussi des cygnes et des singes, sans oublier encore mules et dauphins, ma préférence allant peut-être dans toute cette ménagerie aux ruminations métaphysiques d’un certain Fred d’Aguiar sur la vache, bête maîtresse, comme nulle autre ne sait l’être, dans « l’art absolu d’être laissée en paix ». Cette revue, je l’ai lue une fois revenu dans ma chambre d’hôtel, au calme – enfin, façon de parler. Il faut dire que j’avais pour voisins de bons gros bestiaux, oui, des rosbifs bruyants comme pas permis. Maillots aux couleurs de leur club sur le dos, ces fans anglais venus assister à la finale entre le Racing et Saracens ne passaient pas inaperçus, ni au physique ni au vocal. Dans les couloirs de l’hôtel on n’entendait qu’eux, beuglants à tout va et à toute heure. De vrais poèmes, ces gaillards. Peut-être se croyaient-ils dans un vestiaire, rejouant indéfiniment la troisième mi-temps… D’une certaine manière, en tout cas, on reste dans le sujet avec cette gent-là : quelqu’un écrira-t-il jamais quelque chose sur cette espèce bien particulière de bovins qu’on appelle supporters ?
L.B., 28 mai 2016.
* Aires, deuxième trimestre 1997, n° 25.