
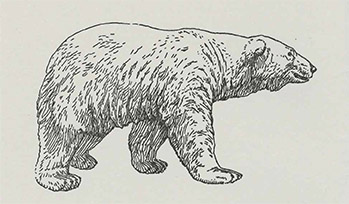
L’Ours Blanc est une revue de poésie bien singulière. Pas de doute, assurément ! Éditée en Suisse, par l’excellente maison Héros-Limite, elle propose de lire de la poésie d’une manière combinatoire, alternative et libre. Expliquons-nous ! Tout d’abord, elle obéit à une fréquence indéfinie, aléatoire. On l’attend autrement que d’autres publications qui nous donnent des rendez-vous fixes. Elle paraît quand elle est prête. C’est un peu comme si la revue n’existait que par une nécessité de l’instant. Et puis, elle est publiée selon un principe de double livraison. De deux numéros en deux numéros donc. Eh oui, L’Ours Blanc nous surprend et fait des bonds. Pour chaque parution, deux petits volumes de couleurs différentes aux polices changeantes semblent se faire face sans qu’on décide aisément s’ils doivent se lire ensemble ou chacun pour soi. Ce n’est pas vraiment un dialogue qui s’instaure, mais plutôt deux propositions qui se font face simultanément. C’est surtout que L’Ours Blanc ne s’en remet à aucune école, ne se cantonne pas à une esthétique, n’affirme pas une identité littéraire qui surplomberait les textes. Au contraire, la revue semble se définir comme un lieu d’accueil, ouvert, disponible.
On aura pu y lire : Marie de Quatrebarbes, Jérémie Gindre, Edoardo Sanguineti, Fabienne Raphoz, David Lespiau ou Charles Reznikoff (écrivain phare de la maison d’édition genevoise)… On perçoit dans ces quelques exemples tirés des 22 premiers volumes de la revue, une espèce de disparité étonnante, et pour tout dire jouissive, revigorante. Pas de dogme, pas de diktats esthétiques, ni de discours tout fait. On y aborde la poésie comme elle vient, singulièrement.
Les nos 21 & 22 ne dérogent pas à cette règle. Ils sont fort dissemblables – et dans leur approche, et dans leur langue, et dans leurs moyens. Tous deux, certes, procèdent d’une opacité qui, au lieu de s’éclairer, de s’estomper, se fouille. Comme on fouille des mains un espace obscur devant soi. L’un et l’autre de ces poètes – Julien Maret et Pascal Poyet – semblent néanmoins animés, leur poésie pour le moins, par un mouvement d’exploration, de re-détermination, de précision. Rien n’y est très bien défini, mais on fouille de plus en plus une matière, comme si la langue, le mouvement de la poésie, se devait d’aller plus profondément dans les choses, le temps, la pensée.
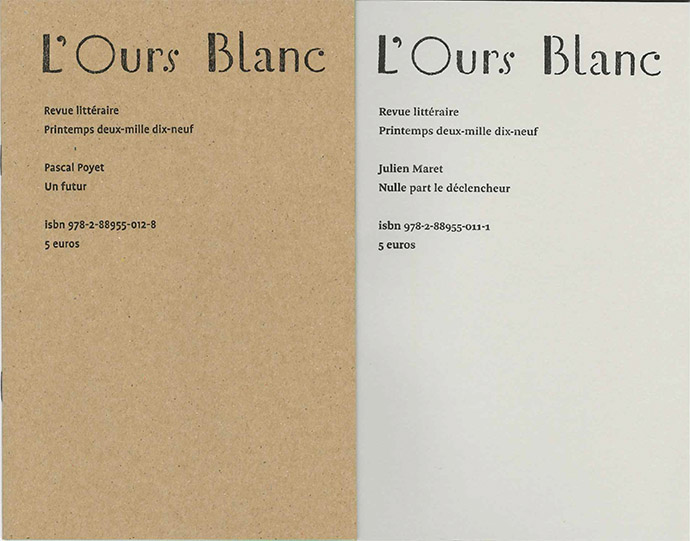
Occupons-nous d’abord de Julien Maret, auteur chez Corti de deux récits assez denses bien que brefs : Rengaine et Ameublement, qui a crée et animé des revues : L’Ablate et Coma. Son texte, ici, intitulé Nulle part le déclencheur se compose de fragments courts, comme enfilés les uns derrière les autres, qui définissent un instant qui préside à une pulsion nostalgique, en tout cas tourné vers un avant, un précédent qui se rappelle, se distingue. Un éparpillement narratif et énonciatif qui diffracte le langage, le désorganise, le fait tâtonner d’un locuteur à l’autre, d’une temporalité à l’autre. Et ce, toujours d’une manière assez indéfinie. Le texte poétique chez Maret avance, toujours, avec une certaine obstination. On y cherche quelque chose qui ne se nomme pas, qu’il faut trouver par soi-même, qui se refuse.
Nous réunis et nous aussi fatigués autour de la lampe et de chandelles le pain cuit dans l’autre pièce le bois brûle dans les hauts fourneaux ce que nous voudrions nous dire nous sommes si clos et il nous semble que parler devient difficile que l’élan se glisse des ralentisseurs de minuscules gênes nulle distance nulle barrière nulle part nous assemblés et démunis quand nous le sommes
Pascal Poyet, à son tour. Poète, traducteur – de Charles Olson, John Baldassari, Peter Gizzi par exemple… – situe la poésie dans le prolongement de langue elle-même. Entendons-nous, elle se nourrit, provient d’une autre. Elle produit une pensée à partir de la langue qui passe par un autre. Sa poésie est assurément altérée, autre, avec. Ici, dans Un futur, il part de la proposition, presque un cliché de la philosophie, de Ludwig Wittgenstein à la fin du Tractatus logico-philosophicus : « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. » Pour commencer, disons-le, tous les clichés masquent quelque chose de bien plus opaque que ce qu’il exemplifie. Et Poyet propose ainsi des segments qui réarticulent, glosent, commentent cette formulation, l’explore jusqu’à ses limites. Il l’aborde par le bien de la traduction, des possibles, des formulations, des interprétations qu’elle fait jaillir de l’énoncé. C’est une poésie qui travaille, appose, compare, modifie, combine.
Exemples : Ce qu’on ne peut pas taire, il faut en parler. Comment s’en empêcher ? Ne faut-il parler que forcé ? Parler forcé de ce qu’on ne peut pas taire ? Parler ouf de ce qu’on ne peut faire autrement que parler ? Un soulagement.
Sur ce dont il n’est pas possible de parler, il faut garder le silence. Ou que (on essaie autrement) : Ce dont on ne peut parler, on doit le taire. Que sur ce dont on ne peut parler, on doit garder le silence.

C’est « un état de choses », « c’est l’aveu, ou la revendication carrément – mais aussi, Ce qu’on ne peut pas dire, on en parlera. » Le traducteur pense ainsi la traduction et réélabore de la pensée à partir d’un énoncé qui la concerne. Idée et langue ensemble. Ainsi, la première section de son texte relève de ce commentaire-traduction, de cette glose érudite et lucide. La seconde procède, au contraire de la définition, de l’accumulation, de la prospection. C’est un travail différent du sens qui s’y amorce et s’y déploie. Elle obéit à une conjugaison du futur. La poésie ici est plus qu’un langage strictement, elle opère dans la pensée, à partir de la pensée. Elle s’articule, provient, d’une pensée philosophique que la traduction transforme, intègre à un autre espace mental, la reconduit, la relance, la prolonge quasi indéfiniment.
L’ours Blanc nous fait ces deux propositions qui ordonnent des distances face au sens, réordonnent le temps, déclenchent quelque chose en nous, soit pour y revenir, soit pour le trouver. Et c’est bien, ça, c’est sûr.
Hugo Pradelle