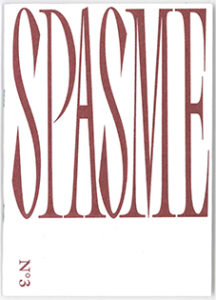

D’abord il aura fallu entendre parler d’elle, l’apercevoir lors d’une apparition (elle ne court pas les librairies). Il faut s’y attendre, fréquenter ses amis, être dans ses réseaux.
Alors peut-être la rencontrerez-vous. Mais elle ne se livrera pas, pas si facilement. Elle se protège, si fragile sous des transparences artificielles. Passez cette barrière, il faudra ensuite user de la lame pour couper cette bande d’une couleur atténuée – lie-de-vin, violine, aubergine ? – qui porte le titre et le numéro de tirage, ici 198/300.
Vous pouvez enfin écarter la couverture muette, blanche de la revue. À moins que…
Que ce ne soit encore une épaisseur, une jaquette : oui, apparaît la première page portant en grand Spasme, et n° 3 !
N’écartez pas la jaquette, dépliez-la délicatement : elle recèle à son revers une belle image, troublante.

Louise Gros, p. 20
Et vous y voilà : Spasme s’offre à vous, pâle et fragile, fort bien imprimée en risographie par Quintal Édition à Paris. L’encre est de même teinte pour les textes et les illustrations. Elle concourt à renforcer cette unité, qui ferait croire que les illustrations sont de la, du même artiste : ils sont trois, quatre, cinq ? Ils ne seront nommés qu’aux dernières pages, où la revue rend à chacun, textes et images, ce qui lui revient. Je ferai de même ici : les noms sont cités à la fin de ce compte rendu. Les reproductions procèdent par fragments, enchevêtrements, reconstruisent des corps de désirs où l’envers/l’endroit, le masculin/féminin n’ont plus cours, où les éléments évidemment sexués disparaissent pour la peau seule et des membres aptes à la préhension, la caresse ; un fragment, torse féminin mutilé ou esquissé ? ; des cadrages serrés coupent les têtes des amants, ne montrant que l’étreinte – et Le spasme (page 20, tendue et paroxystique) ; ouvrant et fermant le ban, des visages enchevêtrés, superposés, états des désirs ou réalités de corps multiples en acte. Est-ce un défaut que la transparence de ce papier blanc ? Ou un autre élément de trouble qui achève l’enchevêtrement ?
Les textes sont courts et selon, emplissent la page ou la laissent respirer, haleter, mais tous s’accrochent à la pliure par une sinuosité discrète, moins affirmée que la courbe d’un sein, le galbe d’une hanche.
Coquetterie ? Élégance plutôt, qui permet les crudités : l’érotisme le nécessite, ce soin apporté aux détails donne toute latitude pour varier les plaisirs sans faillir et tomber dans le graveleux. Et ces textes courts (jusqu’à 8 pages pour « Les yeux fermés ») présentent chacun une facette du prisme amoureux… ou désirant. Les auteurs sont rejetés au sommaire à la fin, quand le titre s’amuse parfois en haut des pages.
L’éditorial de Anne Devoret rappelle l’importance des demi-teintes, de la pénombre pour que puisse se déployer le(s) désir(s).
Elle signe le premier texte, histoire d’une brève rencontre qui commence dans une librairie.
« Il pleut », proposé par une auteure, est comme son titre l’indique : écrit au masculin, empli de fluides, précis et imprégné. Intense.
Le long poème qui suit égrène les raisons, redit les doutes, ressasse les désirs, infinis et recommencés, pourquoi « Je ne dors pas la nuit ».
« Rêver » a la concision des songes qui vous éveillent avec la netteté des sensations, « Et je me suis endormie, apaisée ».
Alors que le long texte de fin n’en finira pas. Pas vraiment. Ce n’est pas un trouble dans le genre tel qu’on pourrait le croire aux premiers mots « C’est les filles qui… », c’est un déplacement du désir, qui trouve son objet puis son incarnation, c’est une écriture tendue et haletante qui rythme « Les yeux fermés ».
Ingrid Maillard, Maxime Lemoyne, Louise Gros, Hélène Planquelle signent les œuvres plastiques ; Anne Devoret, Laure Samama, Gaëtan Didelot, Gabrielle Jarzynski, Cédric Ledoux les textes.
Yannick Kéravec