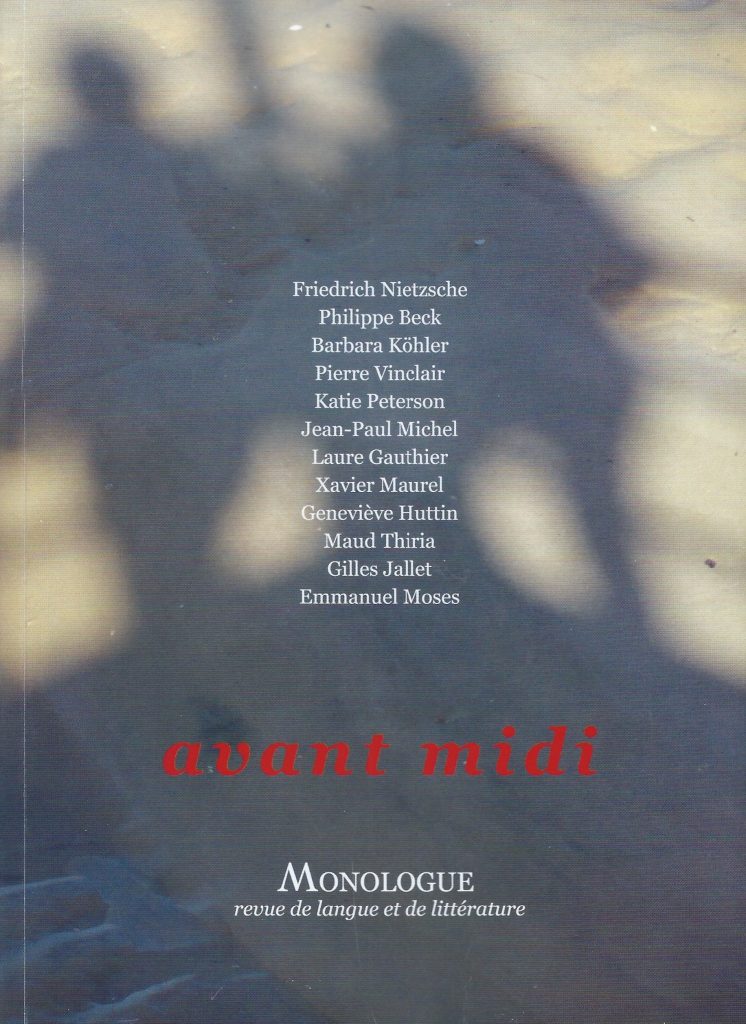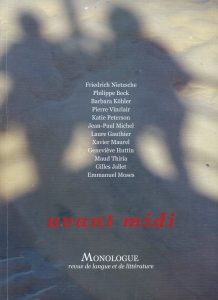
Monologue n’en est pas à son coup d’essai. Cette revue a une histoire, un arrière-plan, disons. Il faut remonter à la fin des années 80 ; Gilles Jallet et Xavier Maurel étaient déjà aux manettes et le projet portait ce même sous-titre exactement : « revue de langue et de littérature ». Pourtant, curieusement, ce passé n’est pas mentionné, comme si le tandem souhaitait ne pas regarder en arrière mais repartir de zéro. Ne pas revenir sur ce qu’il y a eu avant ; seulement aller de l’avant. Nulle indication, donc, qu’il s’agit là d’une nouvelle série, comme cela se voit habituellement quand on relance une publication.
Quoi qu’il en soit vraiment de cette relation au Monologue première version, la revue est là, au présent, frappée de son titre dont la graphie passerait presque inaperçue, n’était ce M majuscule faisant irrésistiblement penser à un W retourné. On peut peut-être voir dans cette idée du retournement typographique l’orientation même de la revue, car ici la langue à l’œuvre se retourne souvent sur elle-même. À travers des textes qui pour la plupart se donnent comme des poèmes, l’écriture des uns et des autres se montre réflexive et cette réflexivité, précisément, nous fait un peu penser à ce que Walter Benjamin appelait « images de pensée », entre introspection et expérimentation. C’est toutefois sous le patronage d’un autre penseur, Nietzsche, que cette livraison se place, et plus exactement sous le signe de son texte Le Voyageur. La notion du voyage, avant tout intérieur, sous-tend les contributions de la douzaine de participants au sommaire. Et l’on pourrait, par jeu, circuler d’un texte à l’autre en relevant des correspondances, en repérant des échos.
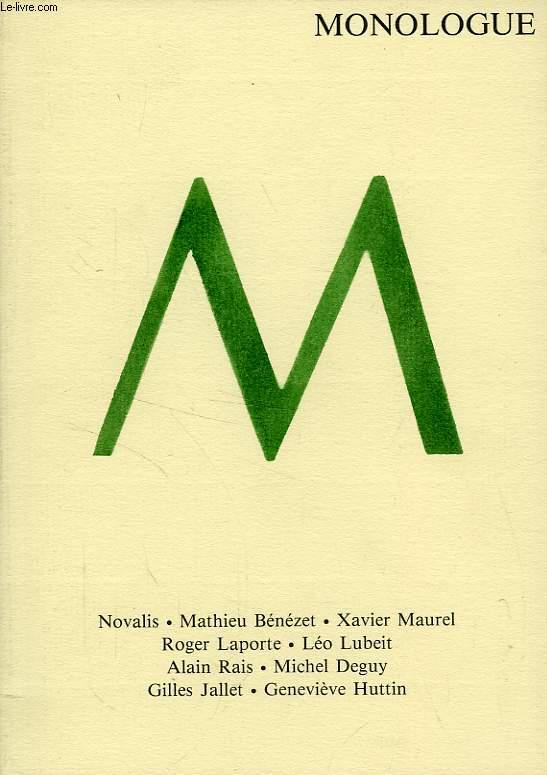
Relions, par exemple, la « prose brisée » de Jean-Paul Michel, transcription de carnets de 1996, qui fait entendre la parole d’un fou (pas si fou que ça) et l’esprit de la correspondance poétique, chez Neruda, « raccord tangible de la plainte lyrique et de la foi épique », selon Geneviève Huttin dans un texte de 1984 (cette dernière était d’ailleurs, déjà, du tout premier numéro de Monologue, en février 1987). Dressons une autre passerelle, entre « la traversée de l’errance », le voyage « sur la corde tendue comme un rasoir coupant » (Maud Thiria), « les vies en transit », l’ombre « éternelle voyageuse, errante sans repos » (Emmanuel Moses), peut-être celle d’un migrant, et « le véritable voyage où il n’y a plus ni dedans ni dehors » (Gilles Jallet). Ou cette autre encore, qui nous ferait passer par un souterrain, ou plutôt une « grotte », terme commun aux deux, de Laure Gauthier à Xavier Maurel : chez elle recherche, à travers les mots, d’« une signature de l’être », chez lui tentative sans cesse de « reproduire la venue au langage ». On pourrait aussi, ailleurs, réunir dans une même équation les variations (un peu trop hermétiques…) de Philippe Beck, la géométrie sensitive de l’Américaine Katie Peterson et la mathématique langagière intime de l’Allemande Barbara Köhler, dont les soliloques illustrent ou du moins prolongent une épigraphe signée Wittgenstein où il est question de la langue comme instrument de démultiplication. « L’ombre de Wittgenstein » passera d’ailleurs, silhouette furtive, dans Les dernières heures du Royaume Uni d’Europe, sous la plume de Pierre Vinclair (le philosophe viennois, rappelons-le, a marqué l’histoire de Cambridge…). Bref, c’est une lecture possible de ce Monologue nouveau, comme on le dit du vin, qui, par antiphrase, se révèle dialogue de parlures qui vont chacune à leur allure, à l’heure du monde, ou non.
Anthony Dufraisse