

Jean-Michel Delacompté (2021) © CC BY-SA 4.0/GaramiAA/Wikimedia Commons
Jean-Michel Delacomptée, né en 1948 et auteur d’une bonne vingtaine de livres, est-il un écrivain qui compte ? Le beau dossier que la revue Possibles lui consacre, s’emploie à démontrer qu’il est un auteur important, injustement méconnu, dont l’œuvre est jusque-là trop souvent passée sous les radars médiatiques. On sent d’ailleurs un peu d’amertume à ce propos dans le texte de l’intéressé – « De la critique littéraire »– qui ouvre cette livraison (n° 31, mars 2024). « Lire Jean-Michel Delacomptée me réjouit », écrit Pierre Perrin, qui préside depuis longtemps à la destinée de cette toujours très ambitieuse parution trimestrielle de littérature. Il ne pouvait donc pas concevoir que ce numéro soit autre chose qu’une occasion de réjouissance. Entouré de six contributeurs qui tous se font lecteurs attentifs et admiratifs – Géraldine Blanc, Olivier Maillard, Laurent Tournesac, Emmanuel Bourreau Chopin…–, Pierre Perrin a réuni des hommages très appuyés. Les uns et les autres sont redoutables d’efficacité dans la promotion d’une œuvre qui cultive un éclectisme certain (essais, portraits, romans, récits) et, il faut bien le reconnaître, un certain élitisme. Car Jean-Michel Delacomptée est un indéniable styliste, un esthète de la langue, pétri de la culture du Grand Siècle, avec tout ce que cela suppose d’exigence et d’érudition. Toutes choses qui font dire à Françoise Richard-Mongereau qu’il est « un classique de nos auteurs français, bien vivant, qui mérite qu’on s’y arrête, qu’on le lise, le relise, le médite et suive les leçons que nous donnent, fort attentionnés et si bien écrits, ses ouvrages. »
Jean-Michel Delacomptée se fait depuis toujours une haute idée de la littérature, et il s’accommode mal de notre époque débraillée et clinquante, artificielle et truqueuse, une époque qui a tout pour hérisser sa plume. Cassandre peut-être moins incendiaire que d’autres mais décliniste quant à sa vision des mœurs contemporaines, c’est par ses indignations que, de toute évidence, il se caractérise avant tout. Notre bel aujourd’hui lui semble décidément une expression bien trompeuse. Il déplore plus que tout qu’on porte sans cesse plus atteinte à la langue. Ou qu’on attente au silence, ce qui pour lui n’est pas loin de constituer un péché capital (lire à ce sujet « Le bruit et ses outrages », de Martine Konorski qui s’appuie sur le Petit éloge des amoureux du silence, ou « L’art du cautère de velours » de Laurent Tournesac, qui évoque le roman La Vie de bureau). On salue ses jugements saignants et cinglants sur le nivellement culturel et la bien-pensance intellectuelle. On vante largement son évident talent de portraitiste – et non de biographe, comme il s’évertue à le préciser souvent – qui le fait passeur de Bossuet, La Bruyère, Racine, Montaigne ou Saint-Simon notamment. On loue sa défense de la sensibilité, car il n’est pas homme de concept…
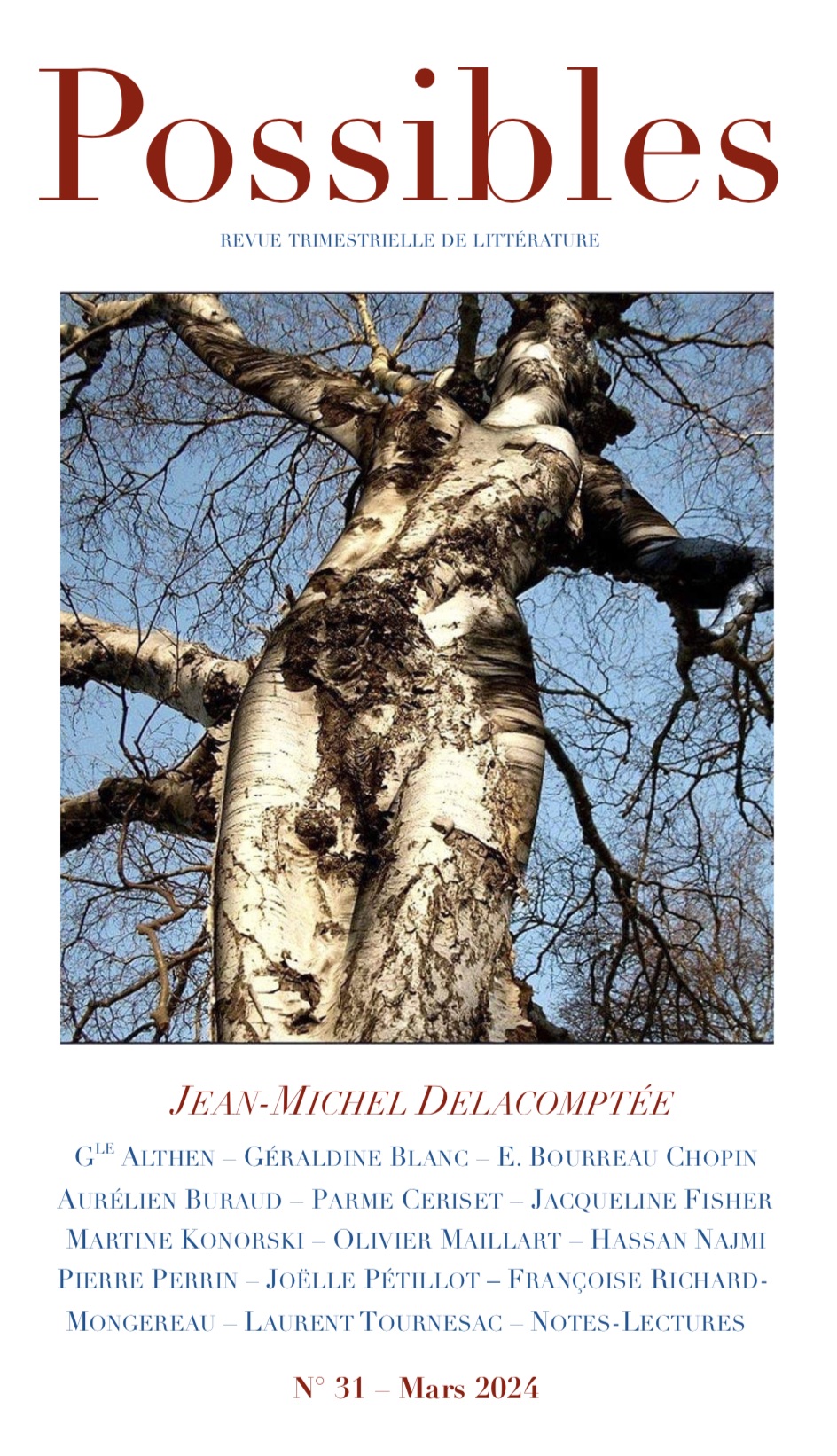
Bref, de tous côtés, dans une pleine et entière adhésion à ses vues sur le temps présent et à sa haute conception de la littérature, celles et ceux qui participent à ce dossier encensent un écrivain qu’ils estiment être l’un des derniers représentants du grand style français. Si quelques répétitions dans le propos entachent, mais sans gravité aucune, cette célébration collective, on regrette un peu que l’œuvre de Delacomptée n’ait pas davantage donné lieu à une approche comparative ; il y avait pourtant matière. On aurait aimé, par exemple, un rapprochement entre Delacomptée et Pascal Quignard autour de l’héritage des moralistes, à commencer par leur pratique commune de la forme brève. Ou, pourquoi pas, un parallèle avec les écrits d’un Jean Clair qui lui aussi, et ô combien, s’est fait virulent contempteur de l’époque, à travers sa dénonciation d’un certain monde artistique tout d’imposture et de la massification de la culture…
Pour l’autre moitié de la revue, on découvre des inédits qui se partagent entre poèmes et prose poétique. L’ensemble fait alterner élans intériorisés du cœur et scintillements lyriques, réminiscences mémorielles et épiphanies du quotidien. Ce qui fait l’orientation de la revue dans cette partie-là, c’est de toute évidence un attachement à la composante narrative : les contributions racontent toutes quelque chose à leur manière. Disons que voilà une poésie-récit, qui murmure des histoires et dessinent les contours d’un théâtre d’ombres, et ce en prenant des formes très variées. Dans une série tout en clair-obscur, Gabrielle Althen oscille entre une tentation élégiaque d’un présent souvent pesant et le désir de quelque chose de plus grand que soi. Aurélien Buraud bouleverse avec ses lettres adressées à l’enfant mort-née ; ses mots tisonnent le souvenir de cette perte à jamais inadmissible. Les poèmes de Parme Ceriset se font, eux, plus baroques, incantatoires presque, comme le très beau Femmes-lumière que rythme une anaphore. Son poème intitulé Vis ! entre même étonnamment en résonance avec La mort, poème du marocain Hassan Najmi traduit par Aymen Hacen : un même résolu carpe diem s’y fait entendre. Ailleurs dans les textes de Najmi, perce l’actualité tragique des migrants ou passent les silhouettes furtives de Brecht et de Pessoa. Sous forme de triptyque, la Suite polyphonique de Jacqueline Fisher relève plutôt, elle, d’un récit d’apprentissage de soi, de cette voix intérieure qui demande à se faire encre et musique des mots. Et puis il y a Joëlle Pétillot qui célèbre la vie discrètement impétueuse, l’ordinaire subitement lumineux qui ne fait pas oublier les heures boiteuses, mais en allège un peu le poids. Elle cherche à rendre l’éphémère perceptible, à étirer l’instant présent, sa densité et son double fond. D’ailleurs laissons-lui le mot de la fin : « Les bruits infimes que fait la vie dans ces traces-là nous bâtissent aussi. »
Anthony Dufraisse