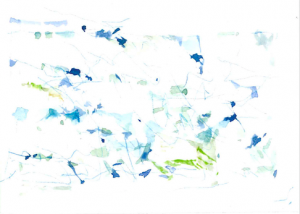« Dans la rue, j’ai vu quelqu’un qui me ressemblait. Mais je ne sais pas comment je me suis rendu compte qu’il me ressemblait. Me serais-je déjà vu ? Je me suis vu de face. Mais c’est son dos que j’ai vu et reconnu comme semblable au mien. Il se penchait pour ouvrir la portière de sa voiture. Le plus étrange est que je ne fus pas du tout surpris, exactement comme André Gide l’a écrit : s’il ouvrait la porte de sa chambre et que derrière se trouvait la mer, il ne serait pas du tout étonné. »
C’est sur ce texte, premier d’une série d’aphorismes de longueurs variées, du poète chinois Wang Wen-hsing que s’ouvre le dernier numéro de la revue de belles-lettres. On pensera peut-être en lisant cette sorte de fable microscopique, au petit garçon, qui, dans le film Yi Yi d’Edward Yang, photographie les nuques de ses proches parce qu’ils ne les voient pas. Mais c’est surtout car il donne une tonalité particulière à cette livraison qui semble chercher à comprendre ce que fait voir la poésie, ce qu’elle peut saisir du discontinu incompréhensible du réel.
Ainsi, comme une colonne vertébrale, on lira des poèmes du poète italien Fabio Pusterla qui y publie deux poèmes, deux brefs essais et propose une sorte de petite anthologie personnelle de poètes italiens qui lui apparaissent importants – Massimo Gezzi, Francesco Scarabicchi, Stefano Simoncelli. On découvre un long poème imaginé à partir de Truganini, dernière survivante aborigène de l’entreprise génocidaire de Tasmanie, et un autre à partir des peintures rupestres de la Grotte Chauvet intitulé « Figurines d’ancêtres » – là aussi les images du film de Werner Herzog s’imposent à la mémoire.
On y lit cette 6e section, superbe :
Dans la caverne tu lisais les traces
gardais le passé. Crachais quelque chose
sur le mur de grès, calquais
ta main. Violent et pierreux
tu fouillais les misères, remontais
aux culpabilités de tous. Aux grandeurs
involontaires de tous. Héroïsme
de l’être qui ignore
même qu’il existe, et qui est.
Derrière les masques les yeux.
Quand tout sera terminé, disais-tu,
nous pourrons à nouveau nous regarder.
Les mains formées aux caresses
les mots à l’amour. Même quand
vous criez et écorchez. Corps ébranlés :
n’oubliez pas la lumière qui est
au-delà de nous. Elle nous traverse
On découvrira ainsi une poésie qui travaille l’image en profondeur en s’en écartant comme paradoxalement. Passer par les premières images peintes, traces de ce que nous sommes en même temps que projections de ce que nous serons, pareillement saisis. Comme l’indique Marion Graf, si les poèmes de Pusterla sont connus, son travail critique et savant l’est nettement moins. Les lire en regard ici semble assez éclairant et judicieux. Moins convaincu par les poètes qu’il choisit, on vous invite à lire dans la première partie du volume des textes de grande qualité qui, comme derrière la porte de Gide, nous pousse à voir autrement. Et peut-être est-ce l’un des rôles majeurs du poème, non ?
On ne résiste pas à citer encore Wang Wen-hsing qui, avec un ironie et un humour distancié revigorant, écrit : « Vue sur les toits : les sommets bleutés des montagnes ressemblent aux murs de l’immeuble d’à côté. » Julien Burri dans les extraits de Territoires de nuit écrit des apparitions, la vue, la perception, le manque, le vide qui en surgit. Ces textes de grande qualité entrent en écho – la composition de ce numéro est tout à fait remarquable de cohérence – avec le « Orfeo » de Laurent Cennamo :
Ouvre les yeux,
vois ce tronc noueux, cet air trop chaud
qui s’enroule comme un serpent à ras de terre,
ce ciel laiteux. Tu ne sais pas que là-bas
on creuse un long tunnel, mais tu ne vois pas
qu’à nos pieds s’ouvre la galerie musicienne
Ce « ras de terre » qui est, écrit le critique chilien Cristián Warnken, au cœur de la poétique de Philippe Jaccottet auquel il consacre un article, rappelant qu’il aurait « voulu parler sans images, simplement / pousser la porte… » Là aussi, on y contemple le monde ! On lira aussi dans ce numéro une série d’hommages à Pierre Chappuis disparu en décembre dernier. Inégaux, peut-être assemblés rapidement, ces textes mettent en lumière un « poète attentif aux lisières, au fugace et au discontinu », écrit Marion Graf. Le plus intéressant sans doute sera de lire la vingtaine de lettres qu’il échangeât avec Jean-Luc Sarré à qui il écrit en octobre 1992 à propos de Rurales, urbaines et autres : « On trouve là confirmation (si besoin était) de ce que les poèmes font pressentir, l’autre visage, comme tu dis, dont le poème n’a pas à se soucier, qui toutefois est présent. Le même tact, ici et là, une approche toute en nuances des choses, et des êtres, et le refuge toujours prompt dans le silence. »
C’est à cela qu’invite la revue de belles-lettres, publication majeure qui, en plus de nous faire entendre et lire des voix poétiques extraordinaires, sait les faire tenir ensemble, en regard les unes des autres, comme dans une chambre d’échos commune. Ce n’est pas rien décidément !
Hugo Pradelle