
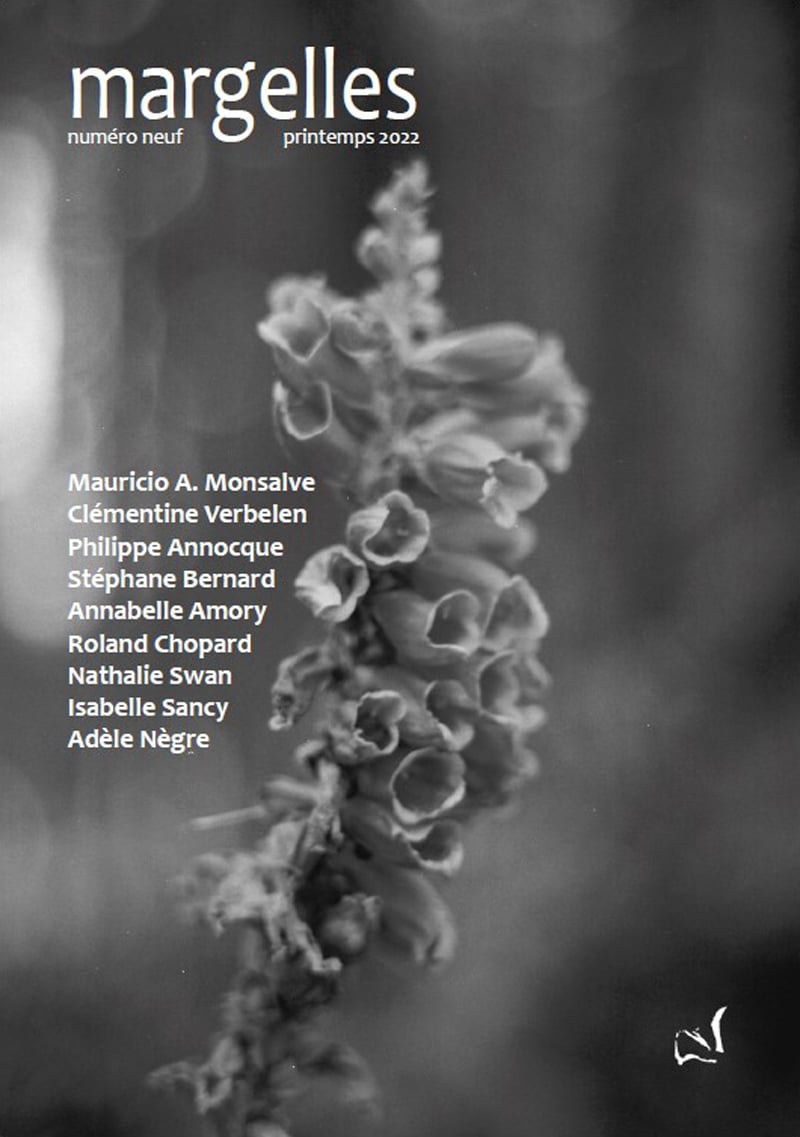
Margelles s’enveloppe de blanc et noir ; Margelles tresse ensemble récits, nouvelles, poésie, photographies ; à l’orée du printemps, point son numéro neuf. L’éditorial s’amuse du mot « neuf ». Pas grand chose de neuf ou presque, en effet, dans cette neuvième livraison. « Quoique ». Et c’est heureux tant le plaisir est grand de retrouver, inchangée, la capiteuse simplicité de la revue qui laisse respirer les auteurs, leurs mots, leurs images – ils sont 9, décidément –, dans de confortables espaces dédiés, élégamment mis en scène. Respiration réciproque du lecteur.
Au printemps de Margelles, renaissent ainsi des plantes familières, déjà répertoriées dans ses parages : Isabelle Sancy, « Plonger sa main dans les herbes folles/contre le chagrin vide de n’être pour rien à leur beauté/y ajouter la sienne. » ; Stéphane Bernard, « Cette rue sans nom, trop aride pour une/graine, j’ai pourtant levé d’elle tout ce/que je suis. Elle est la paille de pierre que/je tète. L’enfance inassouvie. Une soif. » ; Roland Chopard, intime, pour une méditation sur la mort et l’écriture entée sur la disparition d’êtres chers ; Adèle Nègre – suite et ponctuations – en photographe sensuelle.
Mais voici que bourgeonne en amorce de cette livraison, le récit drôlatique et joliment pervers de Clémentine Verbelen qui met en scène le fleuriste Renato, aussi asocial et rustre que passé maître dans l’art du bouquet – n’est-ce pas là talent de femme ? – qui l’embaume du halo d’un gay qu’il n’est pas… Trouble dans le genre.
Un Renato qui pourrait se glisser dans l’une des micro-nouvelles de Philippe Annocque, n’était qu’il lui faudrait changer d’identité et arborer P.N. aux initiales de ses nom et prénom comme tous les personnages (le mot est presque fort) de brefs instants de vie banals où l’aléa redouté jamais n’arrive. Ainsi : « Paco Nombré avait décidé de faire le trajet à pied. Comme le ciel était gris, il prit son parapluie. Mais le temps s’éclaircit et la pluie ne tomba pas. Paco Nombré se dit qu’il aurait aussi bien pu laisser son parapluie à la maison, il l’encombrait pour rien. » Délicieusement ordinaire. Des péripéties à rebours.
Rien d’extraordinaire non plus sinon l’intense beauté de la dense série de photographies de Mauricio Avendaño Monsalve : symphonie paisible en noirs profonds pour capturer l’instant suspendu et piéger la vitesse. Bonheur du simple.
C’est à une autre sensualité que nous ouvre Nathalie Swann, celle des corps, des amants, des peaux, des souffles et des jouissances : « Je te ligote à des vagues et tu saignes en silence de ce qui me fait mal. J’embrasse l’air que tu respires. Je hante ta salive. Je frotte nos baisers à des étincelles. »
Que penser enfin, dans la fable athénienne d’Anabelle Amory, de ce petit chien frisé, figurine de terre, convoité par Hélène sous les voiles d’Artémis l’hétaïre et que lui offre, au rare hasard d’une rencontre, son frère Théophraste sinon qu’il recompose – talisman retrouvé ? – le printemps de l’enfance accordée ?
Non décidément rien de neuf dans ces Margelles éditées par les soins de Bruno Guattari, dans son printemps qui parfois frissonne, sinon le talent renouvelé, le retour heureux de son art éditorial impeccable, de son goût si sûr dans l’entrelacs des textes et des images. Beau geste.
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul : on peut télécharger gratuitement ce numéro mais aussi en acquérir la version papier qui rendra mieux justice à ses noirs qui lui vont si bien.
Frédéric Repelli