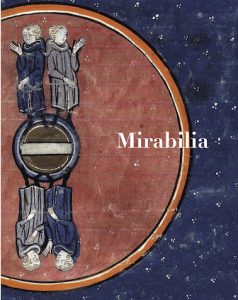

La belle revue Mirabilia relève d’évidence d’une variété. On la lit comme un objet réfléchissant : à partir d’un sujet, d’un thème, d’un mot, elle l’aborde de tous côtés, comme une série de variations qui approchent toutes les formes et toutes les époques. On est toujours surpris à sa lecture par les écarts qu’elle propose, les pistes qui s’y ouvrent soudainement. Elle s’inscrit ainsi dans une tradition culturelle majeure, d’une compilation subjective.
Stupéfiant cabinet de curiosités, la revue s’ouvre à la littérature, aux sciences sociales, aux arts plastiques. Malgré une dimension clairement érudite, elle ne perd jamais de vue le monde présent. Ses animateurs – Anne Gugliemetti et Vincent Gille – s’emploient depuis presque dix ans à interroger nos sociétés, notre réel, nos habitudes, au travers du savoir, de la pluralité que les formes de la connaissance empruntent.
Pour son quinzième numéro, prévu pour le printemps et retardé à ce début d’automne (on notera que ce basculement de saison entre en écho avec des textes de la livraison par une étrange ironie), le sujet choisi frappe par son actualité, son urgence : « la terre ». On s’imagine bien les écueils que l’on pourrait trouver dans une revue consacrée à un sujet si urgent et si conventionnel en même temps… Et pourtant, il s’ouvre, à partir de ce syntagme, une série de textes qui témoignent d’une pluralité qui va de l’écologie à l’art contemporain, en passant par l’exploration spatiale et la connaissance des lombrics ! C’est un numéro élégant, riche, ouvert, généreux ; on est tout autant du côté de la cosmogonie que de la biologie, du savoir encyclopédique que de l’expérience.
Le numéro s’ouvre traditionnellement sur un texte littéraire d’un écrivain majeur. Ici, c’est un récit délicieusement ironique, très ouvragé, de Heinrich von Kleist sur le grand tremblement de terre de Santiago du Chili en 1647 : récit d’amours contrariés, de naissance illégitime, de condamnation qui, au travers de l’expérience cataclysmique, se renversent sur le plan moral. C’est délicieux, sophistiqué, drôle. La terre est d’abord abordée comme un espace cosmogonique, un élément fondamental de notre conception du monde. Franco Farinelli, dans un texte érudit paru initialement dans Conférence, revient sur sa première représentation conceptuelle et ses racines mythologiques, alors que l’on peut lire une intervention politique de Felix Tiouka en 1984 sur les Indiens en Guyane française, rappelant des droits territoriaux et une certaine relation avec la terre : « nana iñonoli. nana kinipinanon. Iyombo nana isheman. (Notre terre, nous l’aimons, et nous y tenons.) »
Il s’ordonne dans ce numéro une relation essentielle avec la terre. C’est un parcours que Mirabilia nous propose, un cheminement. On découvrira un texte du cinéaste Andreas Horvath qui a tourné Lillian dans le Yukon en 2019 et le texte, très libre, de l’une des actrices du film et photographe Patrycja Planik qui marche et découvre la nature. On est frappé par l’importance dans cette livraison de l’expérience, comme s’il fallait raconter une relation à la terre, à ce qui apparaît comme élémentaire, vital. À des échelles diverses. On découvre des paroles d’astronautes qui raconte la terre vue d’ailleurs, rappelant que depuis l’espace on « prend conscience de sa finitude, de sa fragilité, de ce qu’elle représente et de notre responsabilité par rapport à cette planète. » On visitera la plus ancienne briqueterie de l’Orne, fondée en 1760, suivant chaque étape d’une production précise et méticuleuse, ainsi qu’un dialogue avec Yves Vanhoecke sur son exploitation biologique, qui nous rappelle les étapes d’un changement fondamental dans notre rapport à la terre.
Comme dans chaque numéro, on abordera aussi le thème par des expériences artistiques et les arts plastiques. Au centre de ce numéro on pourra contempler les sculptures de Tidru. Mais surtout, par le biais d’un texte de François Bon publié à l’occasion d’une exposition, sur l’artiste japonais Koichi Kotura. Cet artiste collecte au gré de ses déplacements des échantillons de terre du monde entier, les classe et les présente dans des installations monumentales qui rappellent que « le pouvoir de l’art c’est de faire changer d’avis sur la beauté de la terre ». Pour Bon, « Kurita réveille la terre endormie, en lui réoffrant, comme sacrificiellement, les couleurs que nous avons fait terre ».
C’est que la terre nous relie à l‘invisible par le visible, qu’elle nous fait remonter à nos origines et nous fait entrevoir notre fin. Elle relève tout autant du symbolique que du réel, de la durée que de la ponctualité, elle est nous-mêmes en nous demeurant étrangère. Ce sont ces tensions qu’explore ce beau numéro de Mirabilia, qu’il nous invite à traverser, à lire, comme on chemine.
Hugo Pradelle
